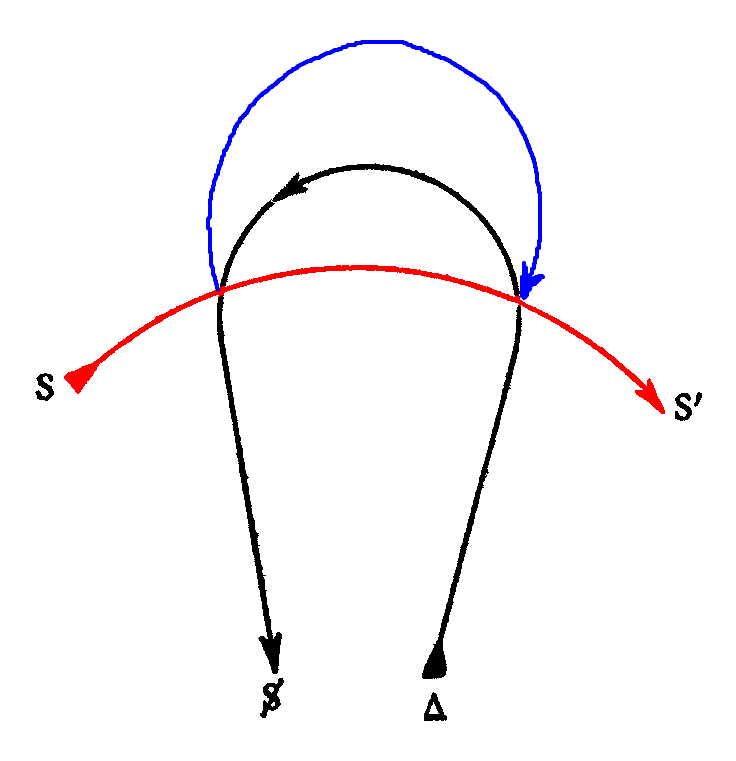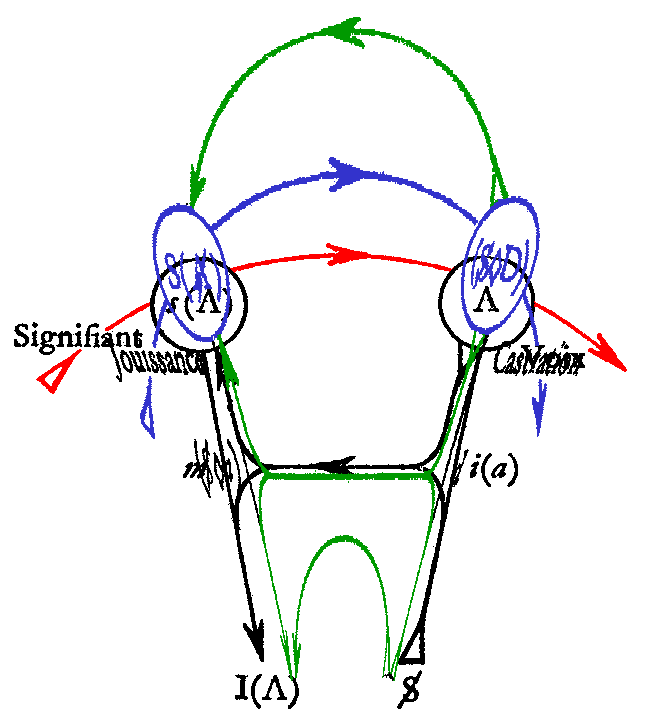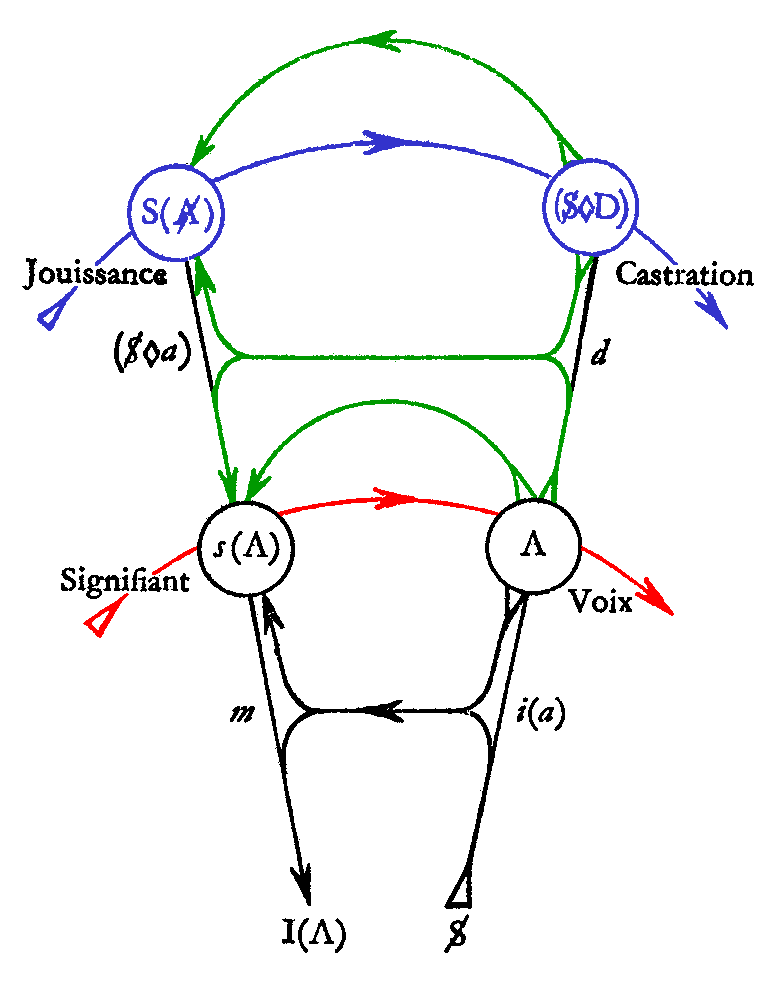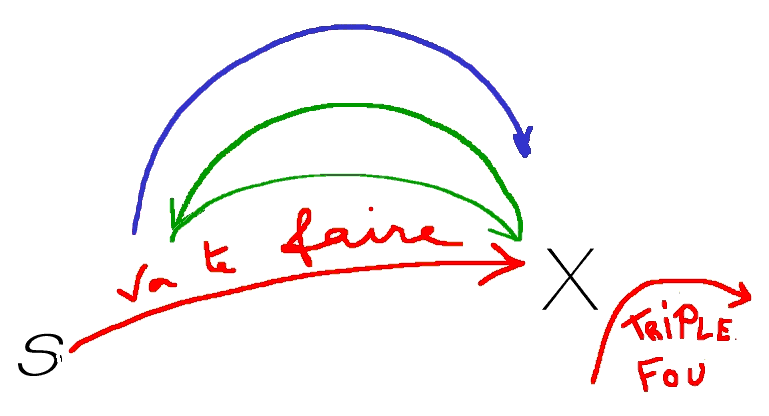|
Question : Dans les Écrits, vous affirmez que Freud anticipe, sans s’en rendre compte,
les recherches de Saussure et celles du Cercle de Prague.
Pouvez-vous vous expliquer sur ce point ? Réponse[1] : ... Saussure et le Cercle de Prague produisent une
linguistique qui n’a rien de commun avec ce qui avant s’est couvert de ce
nom, retrouvât-elle ses clefs entre les mains des stoïciens, – mais qu’en
faisaient-ils ?
La linguistique, avec Saussure et le Cercle de Prague, s’institue d’une
coupure qui est la barre posée entre le signifiant et le signifié, pour qu’y
prévale la différence dont le signifiant se constitue
absolument, mais aussi
bien effectivement s’ordonne d’une autonomie qui n’a rien à envier aux
effets de cristal : pour le système du phonème par exemple qui en est le
premier succès de découverte.
On pense étendre ce succès à tout le réseau du symbolique en n’admettant
de sens qu’à ce que le réseau en réponde, et de l’incidence d’un
effet,
oui, – d’un contenu, non.
C’est la gageure qui se soutient de la coupure inaugurale.
Le signifié sera ou ne sera pas scientifiquement pensable, selon que tiendra
ou non un champ de signifiant qui, de son matériel même, se distingue d’aucun champ physique par la science obtenu.
Ceci implique une exclusion métaphysique, à prendre comme fait de
désêtre.
Aucune signification ne sera désormais tenue pour aller de soi : qu’il fasse
clair quand il fait jour par exemple, où les stoïciens nous ont devancé,
mais j’ai déjà interrogé : à quelle fin ?
Dussé-je aller à brusquer certaines reprises du mot, je dirai sémiotique
toute discipline qui part du signe pris pour objet, mais pour marquer que c’est là ce qui faisait obstacle à la saisie comme telle du signifiant.
Le signe suppose le quelqu’un à qui il fait signe de quelque chose.
C’est le quelqu’un dont l’ombre occultait l’entrée dans la linguistique.
Appelez ce quelqu’un comme vous voudrez, ce sera toujours une sottise. Le
signe suffit à ce que ce quelqu’un se fasse du langage appropriation, comme
d’un simple outil ; de l’abstraction voilà le langage support, comme de la
discussion moyen, avec tous les progrès de la pensée, que dis-je ? de la
critique, à la clef.
Il me faudrait « anticiper » (reprenant le sens du mot de moi à moi) sur ce
que je compte introduire sous la graphie de l’achose, l, apostrophe, a, c,
h, etc. pour faire sentir en quel effet prend position la linguistique.
Ce ne sera pas un progrès : une régression plutôt. C’est ce dont nous avons
besoin contre l’unité d’obscurantisme qui déjà se soude aux fins de prévenir
l’achose.
Personne ne semble reconnaître autour de quoi l’unité se fait, et qu’au
temps de quelqu’un où se recueillait la « signature des choses », du moins
ne pouvait-on compter sur une bêtise assez cultivée, pour qu’on lui accroche
le langage à la fonction de la communication.
Le recours à la communication protège, si j’ose dire, les arrières de ce que
périme la linguistique, en y couvrant le ridicule qui y rapplique a
posteriori de son fait. Supposons la montrer dans l’occultation du langage
la figure du mythe qu’est la télépathie. Freud lui-même se laisse prendre à
cet enfant perdu de la pensée : qu’elle se communique sans parole. Il n’y
démasque pas le roi secret de la cour des miracles dont il ouvre le
nettoyage. Telle la linguistique reste collée à la pensée qu’elle (la
pensée) se communique avec la parole. C’est le même miracle invoqué à faire
qu’on télépâtisse du même bois dont on pactise : pourquoi pas le «
dialogue » dont vous appâtent les faux jetons, voire les contrats sociaux qu
’ils en attendent. L’affect est là bon pied bon œil pour sceller ces
effusions.
Tout homme (qui ne sait ce que c’est ?) est mortel (rassemblons nous sur
cette égalité communicable entre toutes). Et maintenant parlons de « tout »,
c’est le cas de le dire, parlons ensemble, passant muscade de ce qu’il y a
sous la tête des syllogistes (pas d’Aristote, notons le) qui d’un seul cœur
(depuis lui) veulent bien que la mineure mette Socrate dans le coup. Car il
en ressortirait aussi bien que la mort s’administre comme le reste, et par
et pour les hommes, mais sans qu’ils soient du même côté pour ce qui est de
la télépathie que véhicule une télégraphie, dont le sujet dès lors ne cesse
pas d’embarrasser.
Que ce sujet soit d’origine marqué de division, c’est ce dont la
linguistique prend force au-delà des badinages de la communication.
Oui, force à mettre le poète dans son sac. Car le poète se produit d’être…
(qu’on me permette de traduire celui qui le démontre, mon ami Jakobson en l’
espèce)… se produit d’être mangé des vers, qui trouvent entre eux leur
arrangement sans se soucier, c’est manifeste, de ce que le poète en sait ou
pas. D’où la consistance chez Platon de l’ostracisme dont il frappe le poète
en sa République, et de la vive curiosité qu’il montre dans le Cratyle pour
ces petites bêtes que lui paraissent être les mots à n’en faire qu’à leur
tête.
On voit combien le formalisme fut précieux à soutenir les premiers pas de la
linguistique.
Mais c’est tout de même de trébuchements dans les pas du langage, dans la
parole autrement dit, qu’elle a été « anticipée ».
Que le sujet ne soit pas celui qui sache ce qu’il dit, quand bel et bien se
dit quelque chose par le mot qui lui manque, mais aussi dans l’impair d’une
conduite qu’il croit sienne, cela ne rend pas aisé de le loger dans la
cervelle dont il semble s’aider surtout à ce qu’elle dorme (point que l’
actuelle neurophysiologie ne dément pas), voilà d’évidence l’ordre de faits
que Freud appelle l’inconscient.
Quelqu’un qui l’articule, au nom de Lacan, dit que c’est ça ou rien d’autre.
Personne, après lui maintenant, ne peut manquer à le lire dans Freud, et qui
opère selon Freud à psychanalyser, doit s’y régler sauf à le payer du choix
de la bêtise.
Dès lors à énoncer que Freud anticipe la linguistique, je dis moins que ce
qui s’impose, et qui et la formule que je libère maintenant : l’inconscient
est la condition de la linguistique.
Sans l’éruption de l’inconscient, pas moyen que la linguistique sorte du
jour douteux dont l’Université, du nom des sciences humaines, fait encore
éclipse à la science. Couronnée à Kazan par les soins de Baudouin de
Courtenay, elle y fût sans doute restée.
Mais l’Université n’a pas dit son dernier mot, elle va de ça faire sujet de
thèse : influence sur le génie de Ferdinand de Saussure du génie de Freud ;
démontrer d’où vint à l’un le vent de l’autre avant qu’existât la
radio.
Faisons comme si elle ne s’en était pas passé de toujours, pour assourdir
autant.
Et pourquoi Saussure se serait-il rendu compte, pour emprunter les termes de
votre citation, mieux que Freud lui-même de ce que Freud anticipait,
notamment la métaphore et la métonymie lacaniennes, lieux où Saussure genuit
Jakobson.
Si Saussure ne sort pas les anagrammes qu’il déchiffre dans la poésie
saturnienne, c’est que ceux-ci jettent bas la littérature universitaire. La
canaillerie ne le rend pas bête ; c’est parce qu’il n’est pas analyste.
Pour l’analyste au contraire, tremper dans les procédés dont s’habille l’
infatuation universitaire, ne vous rate son homme (il y a là comme un
espoir) et le jette droit dans une bourde comme de dire que l’inconscient
est la condition du langage : là il s’agit de se faire auteur aux dépens de
ce que j’ai dit, voire seriné, aux intéressés : à savoir que le langage est
la condition de l’inconscient.
Ce qui me fait rire du personnage et un stéréotype : au point que deux
autres, eux à l’usage interne d’une Société que sa bâtardise
universitaire a tué, ont osé définir le passage à l’acte et l’acting-out
exactement des termes dont à leur adresse expresse j’avais opposé l’un à l’
autre, mais à intervertir simplement ce que j’attribuais à chacun. Façon,
pensaient-ils, de s’approprier ce que personne n’avait su en articuler
avant.
Si je défaillais maintenant, je ne laisserais d’œuvre que ces rebuts choisis
de mon enseignement, dont j’ai fait butée à l’information, dont c’est tout
dire qu’elle le diffuse.
Ce que j’ai énoncé dans un discours confidentiel, n’en a pas moins déplacé l
’audition commune, au point de m’amener un auditoire qui m’en témoigne d’
être stable en son énormité.
je me souviens de la gêne dont m’interrogeait un garçon qui s’était mêlé, à
se vouloir marxiste, au public fait de gens du Parti (le seul) qui avait
afflué (Dieu sait pourquoi) à la communication de ma « dialectique du désir
et subversion du sujet dans la psychanalyse ».
J’ai gentiment (gentil comme je suis toujours) pointé à la suite dans mes
Écrits, l’ahurissement qui me fit réponse de ce public.
Pour lui, « croyez-vous donc, me disait-il, qu’il suffise que vous ayez
produit quelque chose, inscrit des lettres au tableau noir, pour en attendre
un effet ? ».
Un tel exercice a porté pourtant, j’en ai eu la preuve, ne serait-ce que du
rebut qui lui fit un droit pour mon livre, – les fonds de la Fondation Ford
qui motivent de telles réunions d’avoir à les éponger, s’étant trouvés alors
impensablement à sec pour me publier.
C’est que l’effet qui se propage n’est pas de communication de la parole,
mais de déplacement du discours.
Freud, incompris, fût-ce de lui-même, d’avoir voulu se faire entendre, est
moins servi par ses disciples que par cette propagation : celle sans quoi
les convulsions de l’histoire restent énigme, comme les mois de mai dont se
déroutent ceux qui s’emploient à les rendre serfs d’un sens, dont la
dialectique se présente comme dérision.
|

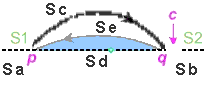
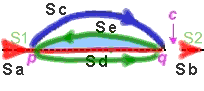
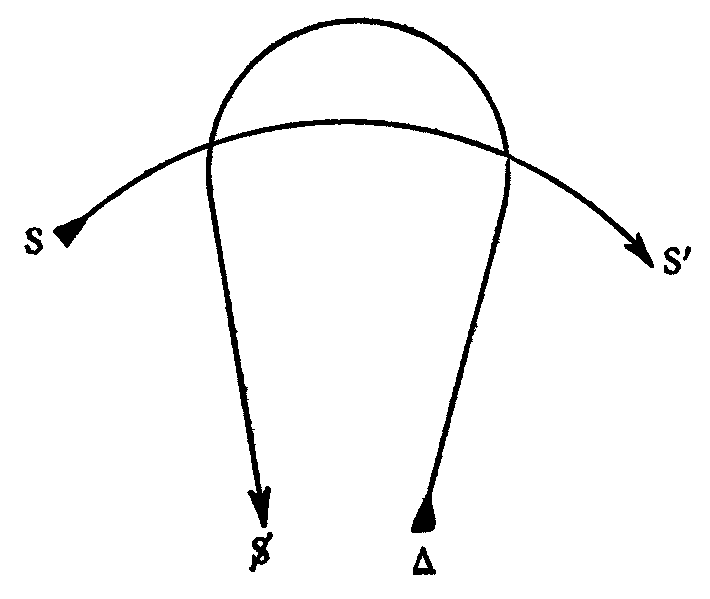
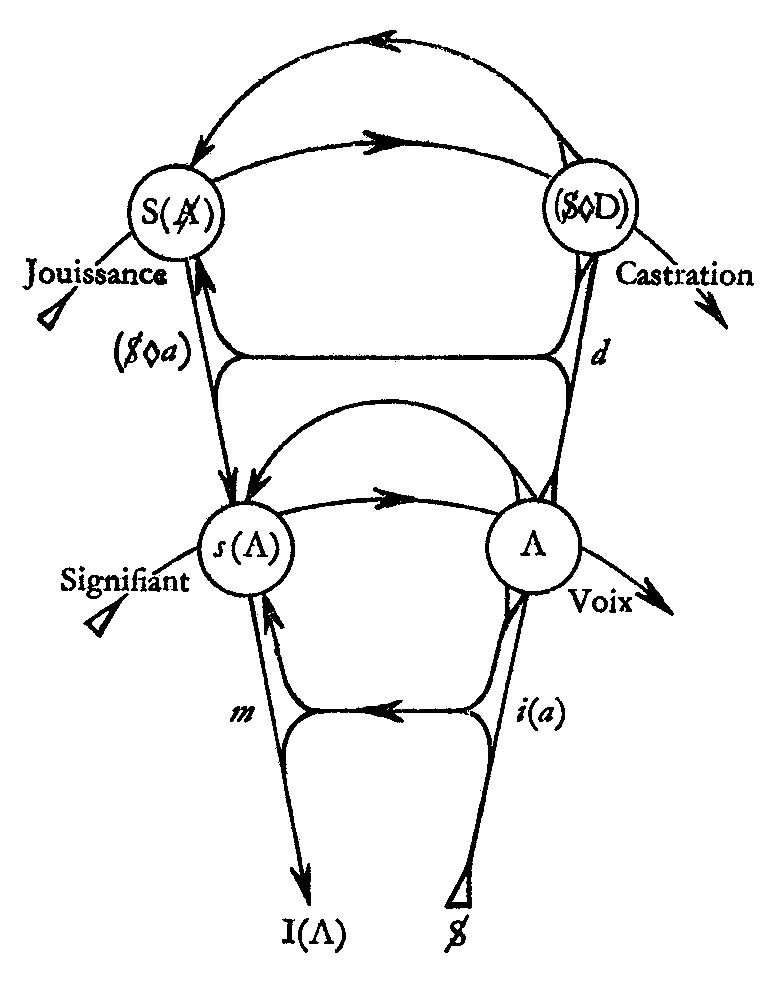 fig : 60
fig : 60